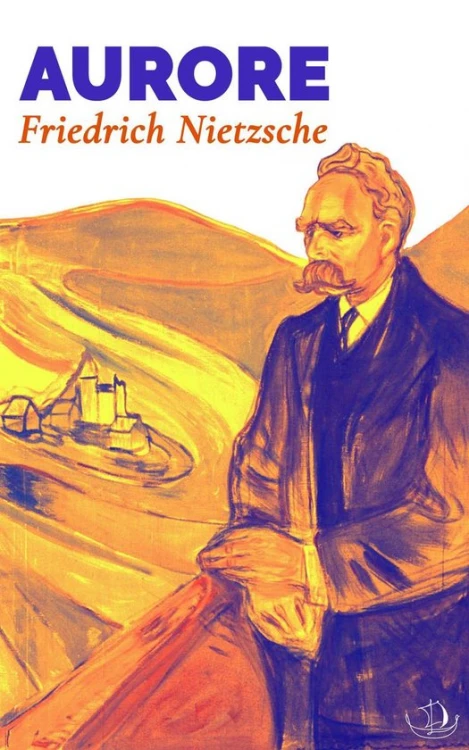Mon intention dans cette chronique n’est pas d’émettre un avis personnel sur Nietzsche, mais juste de donner envie de le lire, car des centaines de penseurs avisés l’ont déjà analysé bien mieux que je ne serais en mesure de le faire. Mais comment aborder un philosophe qui se laisse si peu apprivoiser et qui est plus complexe qu’il n’y parait en quelques mots ? A travers ses nombreux concepts ? En citant des extraits pour tenter d’éclairer ce philosophe si peu docile ? Après hésitation, et surtout il faut l’avouer par facilité, j’essaierai ici la première méthode.
Commençons alors par son plus énigmatique concept : l’éternel retour. N’imaginez pas un simple hasard des circonstances qui vous ferait revivre un événement ressemblant à ce que vous avez déjà vécu une fois dans votre vie ou même à une page de l’histoire avec ses situations à peu près semblables à des plus anciennes. Car il est question dans ce concept d’une identique répétition. Nietzsche envisageait un univers fini, circonscrit et donc limité et il pense que les événements sur des billions et des billions d’années ne peuvent à un moment donné que se répéter et exactement de la même manière à l’unisson de la théorie des probabilités.
Bien sûr, vous n’en saurez rien et vous vivrez toutes les situations de votre quotidien comme lire cette chronique comme si elles n’avaient jamais eu lieu. Ce qui colore ce concept d’une teinte vaguement fantasmagorique. Le seul souci, c’est que le temps dans ce cas précis n’a pas de début ni de fin (ce que les dernières recherches en astrophysique semblent infirmer) et se déploie donc à l’infini à l’image d’une droite qui se refermerait sur elle-même pour former une boucle et ceci un nombre indéfini de fois. Et si Nietzsche a envisagé ce concept (on parle à vrai dire d’une révélation qu’il aurait eue), c’est pour avant tout rejeter la vision eschatologique du monde chrétien. Il n’y a pas de fin de temps chez lui. L’univers est pour lui clos et éternel. Ce qui nous amène à un autre de ses concepts : l’amor fati qui signifie « l’amour du destin ».
Car si tout événement se répète irrémédiablement, l’homme est condamné au déterminisme. Ce qui a eu lieu aura lieu et rien ne pourra l’empêcher. Le libre arbitre n’existe donc pas chez notre philosophe. Que vous agissiez ou pas dans une situation donnée ne change rien à l’affaire : vous êtes prisonnier de la boucle du temps. Nietzsche dit comment on devient ce que l’on est et nous enseigne de surcroit d’aimer ce qui advient dans une acceptation totale du tragique. Et il prend en ce sens complètement à contrepied ce qu’il voit poindre dans la société moderne : une forme d’hédonisme bouddhique.
Autre concept : le surhomme. Qui n’est ni un héros monté sur un destrier et lançant la charge contre un régiment ou Superman sauvant l’humanité en combattant Lex Luthor. Mais plutôt un homme affranchi de Dieu et de ce qui peut l’entraver comme la morale chrétienne pour développer toutes ses possibilités. Et aussi la volonté de puissance (le dénominateur commun de sa pensée) qui s’inscrit dans la pulsion fondamentale de l’homme à chercher l’accroissement de puissance. Ce qui est à mettre en perspective avec la « volonté » de Schopenhauer, une terminologie qui définit un désir de vie aveugle et sans but. Nietzsche en fera cependant une conception positive et volontariste.
Parlons enfin de l’esprit libre qui est pour notre philosophe une forme d’émancipation de l’homme par rapport au milieu qui l’a vu naître. Une indépendance intellectuelle qui préfigure en apparence l’homme moderne. « L’esprit libre hait toutes les règles et habitudes, toutes choses durables et définitives. » Seulement si cela semble faire écho à notre modernité, il ne faut pas perdre de vue qu’il faut rattacher ce concept aux précédents, ce qui rend notre moderne hédoniste et consumériste peu conforme à la définition d’un esprit libre.
Cette présentation n’est bien sûr qu’une mise en bouche qui n’explique que succinctement la complexité de sa pensée qui revêt néanmoins au fur et à mesure de la lecture de ses aphorismes (à part « ainsi parlait Zarathoustra », un long poème, et ses premiers textes, il utilisera l’aphorisme pour laisser plus facilement libre cours à ses pensées vagabondes) une cohérence et une vision du monde singulière.
Nietzsche a ses obsessions : il s’en prendra inlassablement à la morale chrétienne qu’il lie au ressentiment. Il aura ses ennemis comme Saint Paul qui incarne à ses yeux la morale de l’esclave et la haine de soi. Il préférera les écrivains aux philosophes. Sinon les présocratiques à Platon à qui il reprochera de poursuivre des chimères comme il reprochera au christianisme d’avoir dénigré le réel pour un monde idéal. Il nous parlera indifféremment des grandes questions fondamentales comme des petites choses de l’existence trop souvent négligées d’après lui par les philosophes. De l’art comme du processus de création. Préférant toujours la vie aux idéologies mortifères. Et il aura été en définitive celui qui aura réussi à libérer la pensée en refusant ce qu’il appellera les arrière-mondes.
J’ai choisi « Aurore » parce que c’est le livre qui se présente presque comme une accalmie au milieu de la pensée volcanique de Nietzsche et il permettra à mon avis de se familiariser plus facilement avec lui. Mais il n’est pas non plus interdit de picorer de-ci de-là dans ses aphorismes. De refermer les pages de ses livres pour les rouvrir au hasard des années après.
Autres livres conseillés :
Humain, trop humain
Le gai savoir
Ainsi parlait Zarathoustra
Ecce homo