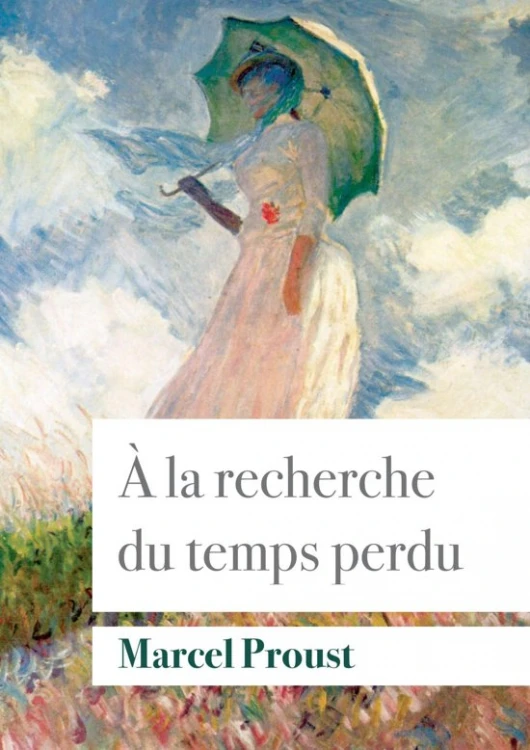Ne cherchez pas dans ce monument de la littérature une quelconque trame, car ce roman est surtout un voyage à travers la mémoire. On parcourt dans « A la recherche du temps perdu » des espaces et des temps différents, ceux par exemple du narrateur enfant angoissé à l’idée que sa mère ne vienne pas l’embrasser avant de dormir, puis ceux se déroulant quelques années plus tard dans le salon parisien de madame Verdurin, une bourgeoise mondaine et prétentieuse, dans lequel on croise Charles Swann rongé par la jalousie, poursuivant de ses assiduités une coquette, Odette de Crécy, qui ne cessera pour son plus grand malheur de pratiquer l’art de l’esquive.
Et ce voyage est avant tout sensoriel. A la description psychologique (quasi clinique) des personnages se mêlent les impressions subjectives du narrateur comme celle laissée par une goutte d’eau sur les pétales d’une fleur ou la projection soudaine de l’ombre d’une rambarde d’un balcon sur un sol. Des impressions qui se déclinent indéfiniment à l’image de la série des cathédrales de Rouen peintes par Claude Monet à de différents moments de la journée.
Et si Proust peut être qualifié d’écrivain impressionniste, il accordera dans son roman une place prépondérante au temps. Une madeleine trempée dans une infusion comme le tintement d’une cuillère fera ressurgir le passé (chez Proust le souvenir se manifestant toujours par la perception) du narrateur qui n’aura de cesse de partir à sa recherche. Mais moins que le passé ressuscité, c’est un présent différé, hors du temps, presque métaphysique, qu’il découvrira dans « Le temps retrouvé », la dernière des 7 parties qui concluent son monumentale œuvre.
Proust s’attachera cependant à décrire un monde à l’agonie, illustré par la scène hallucinante et cruelle du bal des têtes dans laquelle le narrateur retrouve des années après les avoir vues, des connaissances qu’il reconnait à peine. Des hommes et des femmes vieillis telles des apparitions surnaturelles comme grimés par les effets du temps.
« Non seulement, au lieu de sa barbe à peine poivre et sel, il s’était affublé d’une extraordinaire barbe d’une invraisemblable blancheur, mais encore c’était un vieux mendiant qui n’inspirait plus aucun respect qu’était devenu cet homme dont la solennité, la raideur empesée étaient encore présentes à mon souvenir et qui donnait à son personnage de vieux gâteux une telle vérité que ses membres tremblotaient, que les traits détendus de sa figure, habituellement hautaine, ne cessaient de sourire avec une niaise béatitude. »
Et l’on est conduit du salon de madame Verdurin aux ors des appartements de la princesse de Guermantes, lieu où le narrateur est autant un témoin lucide d’une aristocratie amenée à disparaître qu’un acteur fasciné par les personnages qui le remplissent jusqu’à parfois les comparer à des êtres appartenant à une tout autre espèce que la sienne.
On pense aussi à la description de la clientèle aisée du grand hôtel de Balbec où le narrateur séjourne avec sa grand-mère et plus particulièrement à une scène dans « A l’ombre des jeunes filles en fleurs » que Proust dépeint à travers les yeux des autochtones observant de l’extérieur les hôtes de la salle à manger de l’hôtel réunis pour diner. « Une grande question sociale de savoir si la paroi de verre protégera toujours le festin des bêtes merveilleuses et si les gens obscurs qui regardent avidement dans la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger. »
Et si Proust est avant tout le romancier de l’intime, il n’en incorpore pas moins par petites touches des éléments extérieurs. L’affaire Dreyfus est évoquée à travers les conversations mondaines. De même, que dans « Le temps retrouvé », Proust fera d’incessantes allusions à la Guerre qu’on ne voit pas et qui semble pourtant tout proche. Il parlera des permissionnaires en sursis égarés dans Paris, extasiés devant les restaurants pleins et les vitrines illuminées comme des bruits lointains des canonnades.
Il est impossible de décrire la multitude de personnages du livre qui finiront pas devenir des êtres à part entière qui auront partagé un peu de notre quotidien : le peintre Elstir, l’insolent Robert de Saint-Loup, l’assommant marquis de Norpois, Françoise, la bonne dévouée, le facétieux et efféminé baron de Charlus, les déroutantes Gilberte et Albertine, etc. Et pour ceux qui seront arrivés au bout de cette odyssée, l’œuvre ne les quittera jamais vraiment. Et pour les autres, à ceux que les premières phrases auront pu rebuter, je leur recommanderai juste un peu de persévérance.